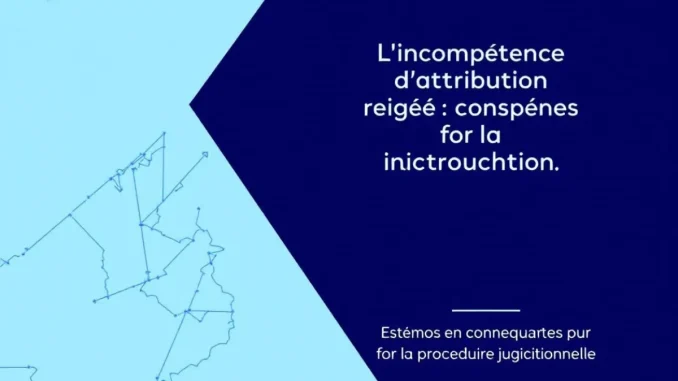
Le système juridictionnel français repose sur une organisation hiérarchisée et spécialisée des juridictions. Chaque tribunal dispose d’un domaine de compétence strictement défini par la loi. Lorsqu’une affaire est portée devant une juridiction qui n’est pas habilitée à en connaître, surgit alors la problématique de l’incompétence d’attribution. Cette irrégularité procédurale majeure peut être soulevée par les parties ou relevée d’office par le juge. Elle constitue un moyen de défense redoutable capable d’interrompre l’instance en cours. La question de l’incompétence d’attribution relevée soulève des interrogations fondamentales touchant à l’organisation judiciaire, au respect du droit au juge naturel et à l’efficacité de la justice. Son traitement procédural obéit à des règles précises dont la méconnaissance peut avoir des conséquences déterminantes sur l’issue du litige.
Fondements juridiques et définition de l’incompétence d’attribution
L’incompétence d’attribution, ou incompétence ratione materiae, se définit comme le défaut de pouvoir d’une juridiction à connaître d’un litige en raison de sa nature. Cette notion fondamentale du droit processuel trouve son assise dans les articles 75 à 79 du Code de procédure civile qui organisent son régime juridique. À la différence de l’incompétence territoriale, l’incompétence d’attribution touche à l’ordre public et ne peut faire l’objet d’une prorogation conventionnelle de compétence.
Le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, issu de la loi des 16-24 août 1790, constitue la pierre angulaire de la répartition des compétences entre les deux ordres juridictionnels français. Ce dualisme juridictionnel implique une stricte délimitation des domaines d’intervention entre le juge judiciaire et le juge administratif. Le Tribunal des conflits, institué par la loi du 24 mai 1872, intervient comme arbitre des questions de compétence entre les deux ordres.
Au sein même de chaque ordre juridictionnel, la répartition des compétences d’attribution s’organise selon plusieurs critères :
- La nature du contentieux (civil, pénal, commercial, social, etc.)
- La valeur du litige (taux de ressort)
- La qualité des parties (commerçants, non-commerçants)
La Cour de cassation a précisé dans un arrêt de principe du 22 février 2000 que « l’incompétence d’attribution s’apprécie au regard de l’objet du litige tel qu’il résulte des prétentions des parties ». Cette appréciation doit se faire au moment de la saisine du juge, indépendamment des évolutions ultérieures du litige.
Le Code de l’organisation judiciaire fixe les attributions spécifiques de chaque juridiction. Ainsi, l’article L.211-3 attribue au tribunal judiciaire une compétence de droit commun pour connaître de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles la compétence n’est pas attribuée expressément à une autre juridiction. Les tribunaux spécialisés (commerce, travail) disposent quant à eux d’une compétence d’exception strictement délimitée.
La jurisprudence joue un rôle déterminant dans la délimitation des frontières entre les compétences juridictionnelles, notamment dans les zones grises où les textes manquent de précision. Par exemple, le contentieux des baux commerciaux a fait l’objet d’une construction jurisprudentielle importante pour déterminer les cas relevant du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire.
Modalités de relevé de l’incompétence d’attribution
Le relevé de l’incompétence d’attribution peut s’opérer selon deux modalités principales : soit à l’initiative des parties au litige, soit d’office par le juge lui-même. Cette dualité de régimes témoigne du caractère d’ordre public attaché à cette question procédurale.
Lorsqu’elle est soulevée par les parties, l’incompétence d’attribution prend la forme d’une exception de procédure. Conformément à l’article 74 du Code de procédure civile, cette exception doit être soulevée in limine litis, c’est-à-dire avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Cette exigence chronologique s’explique par la volonté d’éviter les manœuvres dilatoires. La Cour de cassation a confirmé cette rigueur procédurale dans un arrêt du 9 juillet 2014, rappelant qu’une partie ne peut invoquer l’incompétence après avoir conclu au fond.
L’article 75 du Code de procédure civile impose au plaideur qui soulève l’incompétence de motiver sa demande et de désigner la juridiction estimée compétente. Cette obligation de motivation renforce le caractère sérieux de l’exception et prévient les contestations purement dilatoires. La chambre sociale de la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 28 janvier 2015, que l’absence de désignation de la juridiction compétente rendait irrecevable l’exception d’incompétence.
Le relevé d’office par le juge constitue la seconde modalité. L’article 92 du Code de procédure civile dispose que « l’incompétence peut être prononcée d’office par le juge en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ». Cette faculté devient une obligation lorsque le litige relève de la compétence d’une juridiction administrative ou échappe au pouvoir juridictionnel des tribunaux français.
Dans un arrêt du 12 mai 2010, la première chambre civile de la Cour de cassation a précisé que le juge qui relève d’office son incompétence doit respecter le principe du contradictoire. Il doit ainsi inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce point, conformément à l’article 16 du Code de procédure civile.
Le relevé d’office connaît toutefois des limites temporelles. L’article 92 alinéa 2 précise que « devant la cour d’appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d’office que si l’affaire relève de la compétence d’une juridiction administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française ». Cette restriction vise à assurer une certaine stabilité procédurale aux stades avancés du procès.
En matière administrative, l’article R. 351-3 du Code de justice administrative prévoit un mécanisme similaire permettant au juge administratif de relever d’office son incompétence lorsque l’affaire relève de la compétence judiciaire.
Particularités en matière pénale
En procédure pénale, le relevé d’incompétence obéit à des règles spécifiques. L’article 382 du Code de procédure pénale dispose que « le tribunal correctionnel saisi d’une infraction de sa compétence peut, à la demande du ministère public, du prévenu, de la partie civile ou d’office, prononcer le renvoi de l’affaire devant la juridiction compétente ». Les questions d’incompétence peuvent être soulevées à tout moment avant la clôture des débats, marquant ainsi une différence notable avec la procédure civile.
Procédure applicable et effets immédiats du relevé d’incompétence
Une fois l’incompétence d’attribution relevée, que ce soit par les parties ou d’office par le juge, une procédure spécifique se met en place, encadrée par les articles 80 à 91 du Code de procédure civile. Cette procédure vise à garantir la continuité de l’instance tout en respectant les règles de compétence juridictionnelle.
Lorsque le juge constate son incompétence, il doit rendre une décision d’incompétence. Cette décision prend la forme d’un jugement qui doit être motivé, conformément à l’exigence générale posée par l’article 455 du Code de procédure civile. La Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 15 mars 2017, que l’absence de motivation d’une décision d’incompétence constitue un vice de forme entraînant sa nullité.
L’effet principal de la décision d’incompétence est le dessaisissement du juge qui l’a prononcée. Ce dessaisissement est immédiat et total : le juge qui s’est déclaré incompétent ne peut plus connaître de l’affaire sous quelque angle que ce soit. L’article 91 du Code de procédure civile précise toutefois que le juge peut, dans sa décision d’incompétence, désigner la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi si le premier juge était saisi à tort d’un litige relevant du pouvoir juridictionnel des tribunaux français.
Un aspect fondamental de la procédure concerne le renvoi de l’affaire. L’article 81 du Code de procédure civile dispose que « lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir ». Dans ce cas, l’instance s’éteint sans renvoi automatique. En revanche, lorsque l’incompétence est prononcée au profit d’une autre juridiction judiciaire française, l’article 82 prévoit que « le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente ».
Le mécanisme de renvoi automatique, prévu par l’article 96 du Code de procédure civile, constitue une innovation majeure visant à accélérer le traitement des affaires. Ce dispositif permet, lorsque le juge se déclare incompétent, de transmettre directement le dossier à la juridiction compétente sans nécessiter une nouvelle saisine par les parties. Le greffe de la juridiction initialement saisie transmet alors le dossier à la juridiction désignée, avec une copie de la décision d’incompétence.
- Conservation des actes de procédure régulièrement accomplis
- Maintien des mesures provisoires ou conservatoires
- Continuité de l’instance sans rupture procédurale
La jurisprudence a précisé que ce renvoi s’opère avec l’ensemble des demandes, y compris celles formées en cours d’instance. Dans un arrêt du 7 novembre 2012, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que « la juridiction de renvoi est saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif du renvoi consécutif à la décision d’incompétence ».
Un autre effet immédiat concerne l’interruption des délais de prescription et de forclusion. L’article 2241 du Code civil dispose que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ». Cette interruption perdure malgré la décision d’incompétence, ce qui constitue une protection fondamentale des droits des justiciables face aux aléas procéduraux.
La question des frais et dépens
La question des frais et dépens mérite une attention particulière. L’article 97 du Code de procédure civile prévoit que la décision d’incompétence peut statuer sur les dépens afférents à l’instance devant la juridiction incompétente. La jurisprudence considère généralement que ces dépens doivent être mis à la charge de la partie qui a saisi à tort la juridiction incompétente, sauf si cette erreur était excusable compte tenu de la complexité des règles de compétence.
Voies de recours contre les décisions d’incompétence
Les décisions par lesquelles le juge se prononce sur sa compétence sont susceptibles de recours selon des modalités spécifiques qui dérogent partiellement au droit commun des voies de recours. Ce régime particulier s’explique par la nécessité de trancher rapidement les incidents de procédure afin de ne pas retarder indûment l’examen au fond du litige.
L’appel constitue la principale voie de recours contre les décisions d’incompétence. L’article 80 du Code de procédure civile dispose que « les jugements par lesquels le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige sont susceptibles d’appel dans les conditions prévues par les articles 83 à 90 ». Cette disposition ouvre la voie de l’appel même lorsque le jugement a été rendu en premier et dernier ressort en raison du montant de la demande.
Le délai d’appel est considérablement réduit par rapport au délai de droit commun. L’article 84 prévoit qu’il est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Cette brièveté vise à accélérer le règlement des questions de compétence. La Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 28 juin 2018, que ce délai court à compter de la notification régulière du jugement, peu important que celle-ci ne mentionne pas expressément cette voie de recours.
Une particularité procédurale tient au fait que l’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire, même si le litige relève normalement d’une procédure avec représentation obligatoire. Cette simplification, prévue par l’article 85 du Code de procédure civile, vise à faciliter l’accès au recours.
La cour d’appel dispose de pouvoirs étendus lorsqu’elle est saisie d’un appel contre une décision d’incompétence. L’article 87 du Code de procédure civile lui permet de statuer sur la compétence et d’évoquer le fond si la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente. Dans le cas contraire, elle renvoie l’affaire à la juridiction compétente qu’elle désigne.
Le contredit de compétence, qui constituait historiquement la voie de recours spécifique contre les décisions d’incompétence, a été supprimé par le décret n°2017-891 du 6 mai 2017. Cette réforme a unifié le régime des recours en matière de compétence en généralisant l’appel, dans un souci de simplification procédurale.
La voie du pourvoi en cassation est également ouverte contre les arrêts des cours d’appel statuant sur la compétence. L’article 87-1 du Code de procédure civile précise que le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt. Le pourvoi en cassation n’est pas suspensif, sauf si l’exécution de l’arrêt risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Une originalité du système français réside dans l’existence du règlement de juges, procédure exceptionnelle prévue par les articles 96-2 à 96-8 du Code de procédure civile. Cette voie est ouverte lorsque deux juridictions se sont déclarées compétentes ou incompétentes pour connaître du même litige, créant ainsi un conflit positif ou négatif de compétence. La demande en règlement de juges est portée devant la juridiction hiérarchiquement supérieure commune aux juridictions en conflit.
Le cas particulier du Tribunal des conflits
Le Tribunal des conflits joue un rôle déterminant dans la résolution des conflits de compétence entre les ordres judiciaire et administratif. Lorsqu’une juridiction judiciaire et une juridiction administrative se sont déclarées incompétentes pour connaître d’un même litige, le justiciable peut saisir le Tribunal des conflits qui désignera l’ordre juridictionnel compétent, en application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits.
Stratégies juridiques et perspectives d’évolution face à l’incompétence d’attribution
L’incompétence d’attribution peut constituer un levier stratégique pour les praticiens du droit qui cherchent à optimiser la défense des intérêts de leurs clients. La maîtrise des règles procédurales relatives à cette exception offre des possibilités tactiques qu’il convient d’analyser, tout en tenant compte des récentes évolutions législatives et jurisprudentielles qui tendent à limiter les stratégies dilatoires.
La première dimension stratégique concerne le choix initial de la juridiction. Le demandeur peut parfois hésiter entre plusieurs juridictions potentiellement compétentes. Dans cette hypothèse, la connaissance approfondie de la jurisprudence spécifique à chaque juridiction peut orienter ce choix vers le tribunal dont les positions sont les plus favorables aux thèses défendues. La Cour de cassation a d’ailleurs reconnu, dans un arrêt du 11 mars 2013, la légitimité du forum shopping interne lorsqu’il existe une option de compétence légalement prévue.
Pour le défendeur, soulever l’incompétence d’attribution peut répondre à plusieurs objectifs :
- Gagner du temps en retardant l’examen au fond du litige
- Obtenir le renvoi vers une juridiction réputée plus favorable
- Déstabiliser l’adversaire en l’obligeant à reconstruire sa stratégie
- Augmenter le coût du procès pour le demandeur
Toutefois, ces stratégies se heurtent désormais à des mécanismes correctifs mis en place par le législateur et la jurisprudence. L’article 32-1 du Code de procédure civile permet au juge de condamner à une amende civile celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a fait application de cette disposition dans un arrêt du 8 novembre 2018, sanctionnant une exception d’incompétence manifestement infondée soulevée dans un but purement dilatoire.
La réforme de la justice opérée par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 a profondément modifié le paysage juridictionnel français, avec notamment la création du tribunal judiciaire issu de la fusion des tribunaux d’instance et de grande instance. Cette simplification de la carte judiciaire vise à réduire les conflits de compétence intra-ordre judiciaire. L’article L.211-3 du Code de l’organisation judiciaire confère au tribunal judiciaire une compétence générale de droit commun qui limite les hypothèses d’incompétence d’attribution.
Le développement des guichets uniques de greffe et des procédures de réorientation interne des dossiers participe également à cette rationalisation. L’article L.212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire permet ainsi au président du tribunal judiciaire de renvoyer une affaire à une chambre spécialisée sans que cette réorientation constitue une décision d’incompétence.
Les modes alternatifs de règlement des litiges (MARL) offrent une perspective intéressante pour contourner les difficultés liées à l’incompétence d’attribution. La médiation ou la conciliation permettent de résoudre un conflit sans avoir à déterminer préalablement la juridiction compétente. L’article 2238 du Code civil prévoit d’ailleurs que ces processus suspendent les délais de prescription, préservant ainsi les droits des parties.
La numérisation de la justice constitue un autre axe d’évolution majeur. Le développement de la justice prédictive et des outils d’aide à la décision pourrait à terme permettre d’anticiper avec plus de précision les questions de compétence, limitant ainsi les erreurs d’orientation initiale des dossiers. Le projet de tribunal numérique porté par le ministère de la Justice envisage la création d’un portail unique de saisine qui orienterait automatiquement les requêtes vers les juridictions compétentes.
Sur le plan européen, l’harmonisation des règles de compétence constitue un enjeu majeur. Le règlement Bruxelles I bis (règlement UE n°1215/2012) a déjà uniformisé les règles de compétence internationale en matière civile et commerciale. Cette dynamique pourrait s’étendre progressivement aux règles internes de répartition des compétences, dans une perspective d’édification d’un espace judiciaire européen cohérent.
Vers une redéfinition de la notion d’incompétence ?
Une réflexion de fond s’impose quant à la pertinence même du concept d’incompétence d’attribution dans un système juridictionnel moderne. Certains juristes plaident pour une approche plus souple, centrée sur la notion de « juge naturel » plutôt que sur des règles formelles de répartition des compétences. Cette approche, inspirée du droit allemand et italien, mettrait l’accent sur la protection des droits substantiels des justiciables plutôt que sur le respect rigoureux des frontières juridictionnelles.
L’impact de l’incompétence d’attribution sur l’efficacité judiciaire et les droits des justiciables
Les questions d’incompétence d’attribution soulèvent des enjeux fondamentaux qui dépassent le cadre strictement procédural pour toucher aux principes directeurs du procès et aux droits fondamentaux des justiciables. L’analyse de ces impacts permet de mesurer les conséquences réelles de ce mécanisme sur l’accessibilité et l’efficacité de la justice.
Le premier impact concerne le droit d’accès au juge, consacré tant par l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme que par l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Les règles relatives à l’incompétence d’attribution, lorsqu’elles sont excessivement complexes ou imprévisibles, peuvent constituer une entrave à ce droit fondamental. La Cour européenne des droits de l’homme, dans l’arrêt Golder c/ Royaume-Uni du 21 février 1975, a rappelé que l’accès au juge doit être concret et effectif, non théorique ou illusoire.
Les conséquences en termes de délais de procédure sont particulièrement préoccupantes. Lorsqu’une affaire est renvoyée d’une juridiction à une autre pour incompétence, le temps de traitement global du litige s’allonge considérablement. Selon une étude du ministère de la Justice publiée en 2020, les incidents relatifs à la compétence allongent en moyenne de 8 à 12 mois la durée totale de la procédure. Cette situation entre en contradiction avec l’exigence de jugement dans un « délai raisonnable » posée par l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
L’impact financier pour les parties au litige ne doit pas être sous-estimé. Chaque renvoi pour incompétence génère des frais supplémentaires : nouveaux actes de procédure, honoraires d’avocats additionnels, frais de déplacement si la juridiction compétente est géographiquement éloignée. Ces coûts peuvent dissuader les justiciables aux ressources modestes de poursuivre leur action, créant ainsi une inégalité d’accès à la justice basée sur des critères économiques.
La prévisibilité juridique est également affectée par la complexité des règles de compétence. Le justiciable non juriste peine souvent à identifier la juridiction compétente pour connaître de son litige. Cette incertitude nuit à la sécurité juridique, principe fondamental reconnu par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2013-366 QPC du 14 février 2014 comme découlant de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
L’impact sur la cohérence jurisprudentielle mérite également attention. La multiplication des juridictions spécialisées conduit parfois à des interprétations divergentes du droit sur des questions similaires. Ces divergences nuisent à l’uniformité d’application de la loi sur le territoire national et fragilisent la prévisibilité des décisions de justice. La Cour de cassation, dans son rapport annuel 2019, a d’ailleurs souligné l’importance de maintenir une cohérence jurisprudentielle entre les différentes formations spécialisées.
Face à ces constats, plusieurs pistes d’amélioration se dessinent :
- Le renforcement des mécanismes de passerelle entre juridictions
- La simplification des règles de compétence matérielle
- Le développement des outils numériques d’orientation des justiciables
- La formation continue des magistrats sur les questions de compétence
Le justiciable doit être placé au centre de la réflexion sur l’organisation judiciaire. Comme l’a souligné le Conseil d’État dans son étude annuelle de 2018 intitulée « La simplification et la qualité du droit », le morcellement excessif des compétences juridictionnelles nuit à la lisibilité du système judiciaire et, par conséquent, à son accessibilité.
La digitalisation de la justice offre des perspectives intéressantes pour surmonter les difficultés liées à l’incompétence d’attribution. Des plateformes numériques intelligentes pourraient orienter automatiquement les requêtes vers les juridictions compétentes, limitant ainsi les risques d’erreur d’aiguillage. Le projet Justice.fr, portail d’information juridique et d’accès aux services en ligne de la justice, constitue une première étape dans cette direction.
La question de la spécialisation des juridictions
Le débat sur l’incompétence d’attribution soulève en filigrane la question de l’équilibre optimal entre spécialisation et simplification du système juridictionnel. Si la spécialisation permet une expertise accrue des magistrats dans certains domaines techniques, elle multiplie les risques d’incompétence et complexifie l’accès à la justice. La création des pôles spécialisés au sein des tribunaux judiciaires constitue une tentative de conciliation entre ces exigences parfois contradictoires.
En définitive, l’incompétence d’attribution relevée représente un révélateur des tensions qui traversent notre système juridictionnel, entre technicité du droit et accessibilité de la justice, entre respect rigoureux des règles procédurales et effectivité des droits substantiels. La recherche d’un équilibre optimal entre ces impératifs constitue un défi permanent pour le législateur et les acteurs du monde judiciaire.
